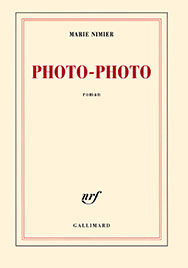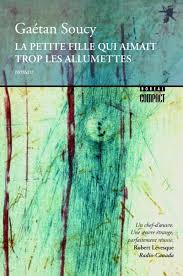Ecrire, dit-elle
Lecteur, lectrice, tu trouveras ici des textes qui approchent l’idée que je me fais d’écrire.
Des textes qui résonnent.
C’est pourquoi ce qui vient en premier, pour moi, dans l’écriture d’un poème (outre que ce n’est pas par l’écriture, mais par une écoute, toujours, qu’il arrive) n’est pas une parole. Pas encore. C’est un son imaginaire. Un morceau de musique – en entendant par là non pas un air complet, chanson ou symphonie, mais, littéralement, un son perçu comme un fragment, quelque chose d’entendu mentalement, plus virtuel qu’audible, quelque chose comme une surprise, un ‘’c’est ça !’’, ou même rien qu’un ‘’ça !’’, un ‘’ah !’’ dans le creux de l’âme entre deux syllabes entrechoquées comme deux silex qui font jaillir l’étincelle d’une dissonance ou d’un accord jamais entendu. Surgi de nulle part. Tout en accomplissant, satisfaisant, comblant et aiguisant, nourrissant, amplifiant, comme la flamme s’augmente du souffle et le besoin de boire se sublime en ivresse, le désir de ce que ce son inouï, qui semble s’être glissé dans une fissure de l’espace-temps, apporte. De tous les étonnements, de toutes les évidences, la plus forte. Ce que l’irruption d’une note inouïe apporte répond à la longue attente de ce vers quoi l’attention de celui qui traverse sa vie en deuil de poésie est constamment tournée : non pas le désir (faut-il encore le dire ?) de la gloire, de la richesse, de l’effusion unanimiste ou de la révolte triomphante, pour ne rien dire des ‘’lendemains qui chantent’’ – ou simplement du bonheur -, mais de l’arrivée, du retour, dans des syllabes qui formeront bientôt des mots qui diront ce qu’il y a lieu de dire dans votre langue, au passage de vingt autres langues, d’un très ancien rêve qui n’était pas allé – ou que vous n’aviez pas réussi à tenir, la dernière fois – jusqu’au bout… il y a longtemps, très longtemps, dans votre enfance probablement mais avant votre naissance aussi sans doute, dans une autre vie, cette espèce de présent voyageur immobile de la mémoire onirique à éclipses soufflé par la nuit et par les morts ; rêve qui s’était interrompu, que vous aviez perdu, qui s’était évanoui comme s’il ne devait, pas plus que les morts, jamais revenir, mais qui, un mois, un an, dix ans, trente ans après, par-delà le tronc contourné d’un arbre du temps, se répond, en écho à lui-même, cri d’oiseau d’une espèce nouvelle reconnu à l’instant dans la forêt où tous les poèmes que vous adorez se tiennent autour de vous silencieux et attentifs. Et du choc de deux syllabes il en nait trois – cela se compte -, cinq, sept, onze, treize, quinze, vingt, tout un poème, scandé dans la figure qui s’invente au même instant comme la matrice de tout ce qui accède à l’existence. Forme unique et toujours singulière, au renouvellement perpétuel, où les mots viennent se couler comme un frisson d’étoiles dans une pierre au temps où elle était encore vivante.
Jean Monod, Ma Poétique 2 https://ani-mots.com/2024/02/06/ma-poetique-2/
« On devrait écrire, dit Hemingway, comme s’il s’agissait de persuader une compagnie d’assurance qui serait d’une méfiance extrême. Chaque récit, voire chaque poème, ne sont-ils pas, par ailleurs, la description d’un accident ? Mais comment décrire cet accident ?
« Rien ne peut être dit, écrit, ni fait qui ne puisse être défini par le langage. Nous l’avons hérité de ceux qui nous ont précédés. Est-ce nous qui le parlons ? Ou bien est-ce le langage qui nous parle ? Nous sommes étroitement liés à cette machinerie du langage dont nous ne savons pas grand-chose. Nous nous débrouillons avec des clichés, des collages… Impossible de saisir la réalité entière à travers ces clichés. […]
« Dans notre monde intérieur nous sommes libres. Il n’a ni contraintes ni obstacles. Notre poème peut donc se situer avant notre naissance, comme après notre mort. Ceci pourrait expliquer l’incompréhension du lecteur face à la poésie d’aujourd’hui., étant donné que le lecteur cherche dans chaque mot le sens littéral sans tenir compte de sa dimension symbolique et de l’aura qui l’entourent…[…]
« Où allons-nous ? Ne faudrait-il pas que nous puissions concevoir une image nouvelle du monde dans lequel nous aimerions vivre ? Où la trouver ? Car jamais dans l’histoire de l’humanité il n’y a eu siècle plus barbare que le siècle dernier. Et les horreurs continuent et se multiplient dans tous les coins du monde. Nous voilà impuissants face à tant de misère, de corruption et de manipulation. Faut-il se résigner au désespoir, au découragement ? […]
« Conscients des barbaries de ce monde ainsi que des limites et des possibilités du langage, une tâche importante s’impose néanmoins à nous poètes, “laveurs de mots” ainsi que Francis Ponge nous qualifiait. […] Notre langue reste sacrée. Notre devoir est de la protéger, de la veiller, comme un feu qui ne doit jamais s’éteindre. Car c’est lui qui précisément doit éclairer la nuit du monde. »
Denise Kolz à l’occasion de la réception du prix Jean Arp de littérature francophone qui lui était remis en l’Hôtel de Ville de Strasbourg dans le cadre des Rencontres européennes de littérature, le 14 mars 2009. (cité dans La Lettre du Lac Noir N° 36 – Avril 2023)
Quand la poésie refuse d’être un ornement ou une collection d’afféteries formelles, elle garde trace des expériences vécues et des risques pris. Elle dit le réel mais en le révélant plus vaste, et d’une prodigieuse intensité. Elle conjugue visible et invisible, sursauts intimes et songes partagés. Elle s’impose comme le chant profond des vivants qui ne renoncent pas aux effractions, aux abîmes, aux combats, ni aux enchantements inouïs de la vraie vie.
Ernest Pignon-Ernest (exposition Ecce homo, Palais des Papes, Avignon automne 2019)
Éditions Bruno Doucey, 2017
Mais c’est aussi l’inclinaison abstraite des mains occupées. La transparence du verre sous l’eau bouillante. Le midi mesuré de toute chose à un lever de matin. L’extension du regard hors de la pupille. Et la tête montgolfière qui le suit. Aux nuées. À l’impensable. Aux tourbillons des planètes et au clinamen des atomes. Aux fractals et au ping-pong des neutrinos.
L’éveil l’espace d’une assiette qui goutte sur l’évier. Le satori en lavant la vaisselle.
La simplicité brûle aussi. Sans flamme. Comme le gel. Expérience brève, geste d’effleurer la nappe de coton, où machinalement la main enroule un fil autour de l’annulaire. Toucher à proportion du corps, la jouissance aux limites du bras tendu, grâce lui soit donnée.
L’inachevé de soi, p. 58
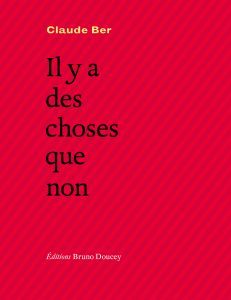
Marie Nimier, Photo-photo,
Gallimard, 2010
« Il est une question que l’on me pose souvent lors des rencontres en public, la question des idées justement. Comment elles arrivent, où je les pêche -le fameux : mais où va-t-elle chercher tout ça ?
J’ai tendance à répondre que les idées n’existent pas, qu’il n’y a que du temps. Ou si elles existent (car elles existent évidemment), elles ont bien peu à faire avec la pratique du roman, son écriture au jour le jour. Elles sont là en amont, le soir avant de s’endormir, couvrent des pages de notes préparatoires, mais au matin fondent comme neige au soleil. S’infiltrent dans les sols, irriguent les décors – n’existent plus en tant que telles. Restent les parties du corps qu’elles ont mises en lumière, les axes qu’elles ont inspirés, les ricochets, les mouvements. Un angle étroit, une spirale biscornue, un cône dessiné par la boucle d’une ceinture. Des pieds, des mains, des yeux, toutes ces choses qui marchent par deux. Je dis encore, ce qui peut sembler paradoxal, que je ne vois pas mes personnages, qu’ils ne sont que des assemblages de mots. Que je vois les mots. »
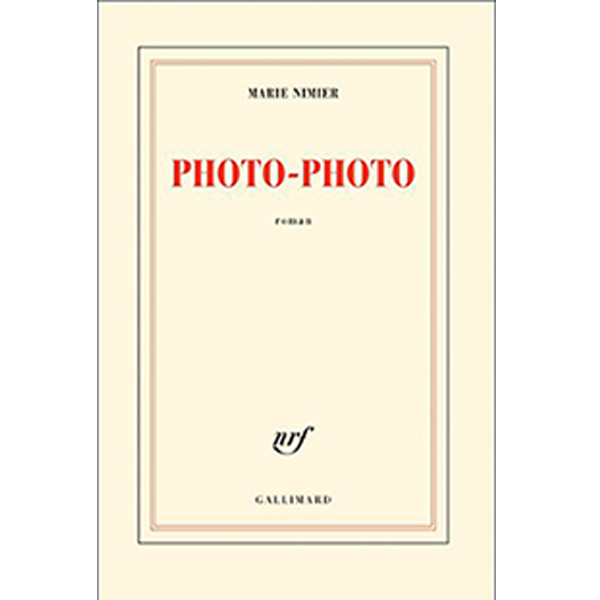
Gaétan Soucy, La Petite Fille qui aimait trop les allumettes
Boréal, avril 1999 (Québec)
« J’avais définitivement compris que nos rêves ne descendent sur terre que le temps de nous faire un pied de nez, en nous laissant une saveur sur la langue, quelque chose comme de la confiture de caillots, et j’ai repris le grimoire, comme ça, au beau milieu du champ ; et mon crayon a poursuivi comme un seul homme, car un secrétarien, un vrai, ne recule jamais devant le devoir de donner un nom aux choses, qui est son office, et je me trouvais déjà assez désarmée par la vie pour ne pas désirer me dépouiller davantage, à l’instar des franciscains et des mules aux yeux doux, et aller jusqu’à me démunir de mes poupées de cendre, je veux dire les mots, tant il est vrai que nous sommes pauvres de tout ce qu’on ne sait pas nommer (…)
(…) je me réfugiais comme de coutume dans mon crayon. Car que faire d’autre qu’écrire pour rien dans cette vie ? D’accord, d’accord, j’ai dit « les mots : des poupées de cendre », mais c’est trompeur aussi, puisque certains, quand ils sont bien rangés en phrases, on reçoit un véritable choc à leur contact, comme si on posait la paume sur un nuage au moment juste où il est gonflé de tonnerre et va se lâcher. Il n’y a que cela qui m’aide, moi. À chacun ses expédients. »

Marie-Hélène Lafon, Chantiers
(éd. des Busclats, mai 2015)
Il a fallu du temps, beaucoup de temps encore, et de savants détours, et des méandres tenaces avant d’oser un autre travail, contigu à celui de la lecture, le travail de l’écriture ; avant d’oser se mettre à l’établi des mots, de la phrase, du texte ; avant d’oser empoigner cette viande-là, viande c’est vivenda, de vivere, c’est ce qui sert à vivre, c’est le vivant, la matière même du monde, avec les arbres, l’échelle, la grand-mère, le rôti, le pré gras, la fille, le garçon, les beaux fruits, la ferme louée, la balançoire, le vert le bleu, la Sorbonne, le pensionnat, l’espalier, et tout le reste. (p. 15)
Les adjectifs, par exemple, prenons les adjectifs ; on peut les traquer, les débusquer, les analyser, épithètes attributs apposés, on dit aussi joliment détachés, épithètes détachés, comme une bête le serait après les longs mois d’hiver passés dans l’étable ; on peut parfois les déplacer, plus souvent les remplacer, on peut s’en passer d’abord, les incruster ensuite, et entendre et voir comme et comment ils font couleur, ils font chair, ils ont puissance d’incarnation, ils sont la viande sur l’os de la phrase nue. (p. 22-23)
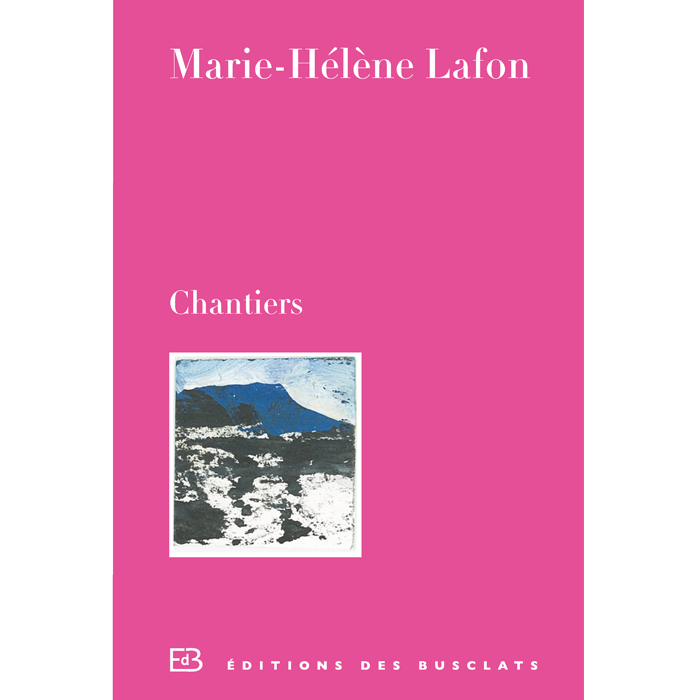
Géraldine Serbourdin, in Décharge 167, Revue trimestrielle
Qu’attendons-nous de la poésie ?
Qu’elle caresse les mots, qu’elle les fasse s’entrechoquer, qu’elle perle les idées et me parle à l’oreille, qu’elle crie l’indignation, la colère et me rende à nouveau rebelle. Qu’elle me fasse tournebouler, qu’elle culbute mes certitudes et m’apparaisse vaine, inutile et sonore. Qu’elle dessine le sens. Qu’elle me donne de la voix, qu’elle me fasse réagir, exister et lutter. Qu’elle soit comme la mer, infiniment recommencée. Vibrant de pulsations dévorantes. Violente et fréquentée. Que je m’en souvienne, que j’égrène, que je colore mes matins tristes et nourrisse ma joie de dire. Qu’elle me surprenne et me donne des rendez-vous clandestins, secrets, le long des champs de blé dont elle me dit la blondeur que j’ignorais encore. Qu’elle m’apprenne à voir. Qu’elle m’attache à moi, qui ne me savais pas. Qui ne m’accueillais pas de cette façon. Lumineuse et si sombre, de leur ombre si soucieuse. Douce. Comprenant enfin que mon enfance se joue avec la langue, se lie avec des mots, que ma parole a du sens, du goût et mon corps une jouissance. La poésie s’écrit contre la connerie, contre la barbarie et le dogme, la poésie réclame les étrangers, prône la cacophonie et le désordre de la pensée, la poésie a du sens. La poésie m’émeut plus encore aujourd’hui que les corps se noient, que les armes se voient, que se taisent des voix.
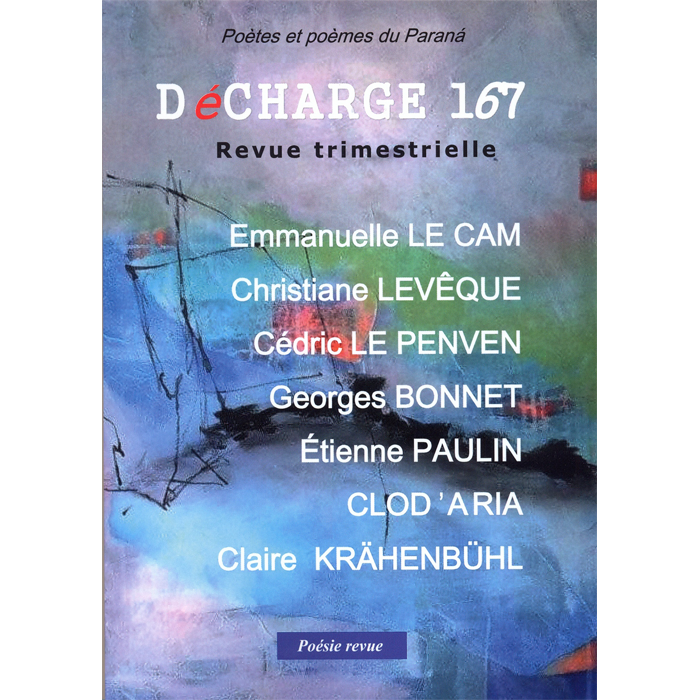
Albertine Benedetto, Revue Décharges n° 168 dans la rubrique « Qu’attendez-vous des poètes » ?
Qu’attendons-nous de la poésie ?
Qu’attendons-nous des Poètes ? Inutile de rapporter ici les paroles des grands poètes, réfléchissant sur cet art mystérieux de l’écriture poétique. Je partirai cependant de cette phrase de Saint John Perse si volontiers citée : « A la question toujours posée : « Pourquoi écrivez-vous ? », la réponse du Poète sera toujours la plus brève : « Pour mieux vivre ». Est-ce cette vie meilleure que nous attendons des Poètes ? Qu’ont-ils à nous donner sinon leurs visions – et qu’ont-ils vu que nous ne voyons pas ? Les poètes éveillent notre présence au monde : soudain, celle-ci n’est plus machinale, comme allant de soi dans une uniformité lasse du regard. Cette pierre est vraiment une pierre, cet oiseau est vraiment un oiseau et nous nous rencontrons, l’espace du poème. Le poème fait jointure, reliure entre un monde absurde et notre présence éphémère et dérisoire. Soudain, il est urgent d’être là avec les choses qui se tiennent rassemblées dans le poème autour de nous, avec nous. Le poète alors nous révèle l’harmonie du monde où nous nous mettons à exister, et non plus seulement à vivre – comme vivent toutes les créatures. Le poète nous révèle notre humanité, consubstantielle à l’expérience toujours renouvelée qui consiste à accéder à cette présence. La poésie est donc un autre nom de l’amour. N’est-ce pas dans l’expérience ineffable de l’amour que je me révèle et que je fais corps avec le monde ? Et c’est toujours la première fois. Le poème est dans cette tension entre un ailleurs que l’on a entrevu, auquel on aspire à revenir, une origine perdue et cet inédit, ce toujours nouveau de toute expérience vraie. Il nous tient éloignés de la routine des yeux et du coeur, de la facilité des habitudes. Il nous contraint à rester éveillés à la beauté du monde, nous y ramène quand nous l’oublions. La poésie nous malmène, nous rudoie parfois car elle nous montre notre paresse. Nous aimerions bien mieux peut-être demeurer dans une torpeur lénifiante, ne pas être secoués par cette émotion qui nous étreint et nous fait sentir qu’un jour il faudra quitter tout cela. La poésie est ce terrible « memento mori ». Elle nous donne le monde pour en clamer l’absence. Et nous qui étions devenus si vivants… angoisse de la perte et de nos bras désemplis de ce que nous aurons tant aimé. Les poètes alors nous consolent et bercent notre peine, ils nous disent que cela vaut le coup. Je n’ai qu’une vie mais je peux tellement en toucher d’autres par la lecture du poème ! Ils me donnent des ailes et des bottes de sept lieues, grâce à eux, rien ne m’est interdit. La poésie est connaissance, naissance avec. Il n’y a plus qu’à accepter de se perdre là où elle nous emmène, de lâcher nos repères, de prendre ce risque d’être égarés, déboussolés, enlevés à la chaîne de notre raison raisonnante. Ainsi, par elle nous accédons au mystère de l’être avec la légèreté des oiseaux. Albertine Benedetto © A Hyères, 9 mai 2015